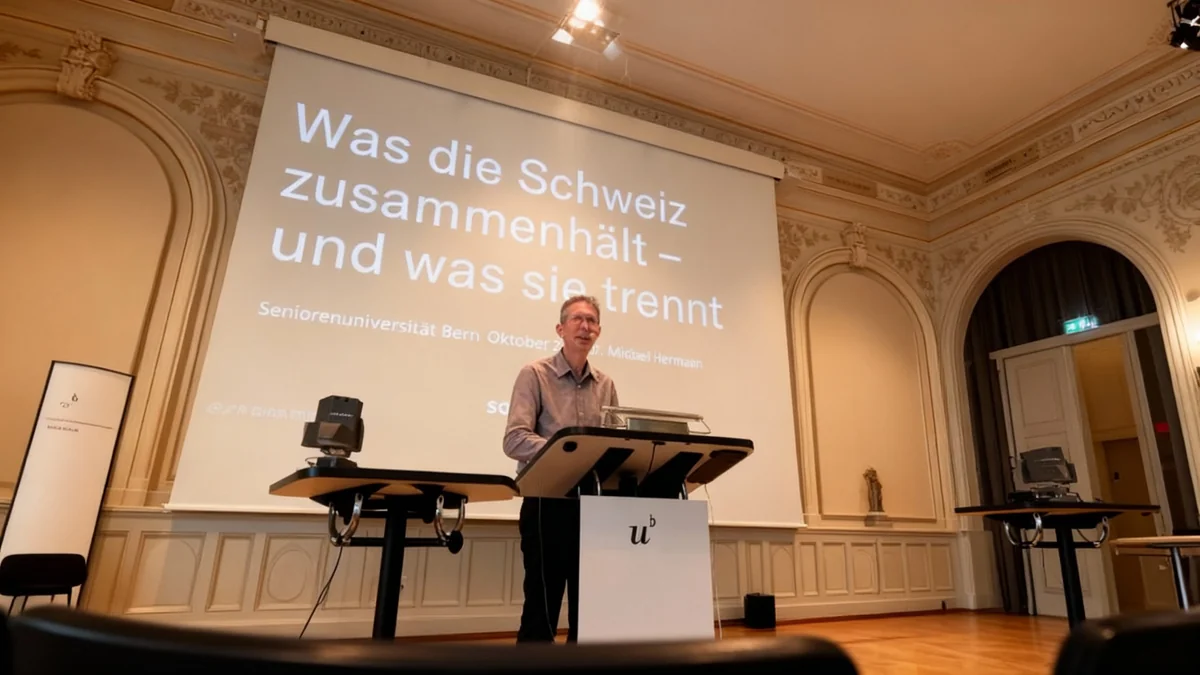Une étude récente menée par l'institut de recherche Sotomo, connue sous le nom de « Generationenbarometer », révèle une perception changeante des relations intergénérationnelles en Suisse. Alors que les jeunes ressentent de plus en plus une fracture, le géographe politique Michael Hermann suggère que la réalité est plus nuancée, soulignant d'autres lignes de faille sociétales.
Points clés à retenir
- Les jeunes générations perçoivent de plus en plus une fracture entre jeunes et moins jeunes en Suisse.
- Michael Hermann soutient qu'un profond conflit générationnel n'existe pas, soulignant d'autres divisions sociétales comme plus importantes.
- Le « principe du c'est mon tour » influence les récents votes populaires, portés par les démographies plus âgées.
- La mondialisation, la numérisation et les pressions de performance contribuent aux tensions sociétales.
- Hermann encourage les jeunes citoyens à participer plus activement à la démocratie directe.
Perceptions changeantes des relations générationnelles
Le « Generationenbarometer » est une étude représentative commandée par la Maison des Générations de Berne. Elle est menée à intervalles réguliers par l'institut de recherche Sotomo. Cette année marque la troisième itération de l'étude, après les rapports précédents de 2020 et 2021.
Pour l'étude de 2025, Sotomo a interrogé 2 754 personnes âgées de 18 ans et plus en Suisse alémanique et romande. Les résultats ont été pondérés statistiquement pour s'assurer qu'ils sont représentatifs de la population résidente. Les conclusions indiquent un changement notable d'orientation par rapport aux années précédentes.
Aperçu de l'étude
- Participants : 2 754 personnes âgées de 18 ans et plus
- Régions : Suisse alémanique et romande
- Fréquence : Troisième itération (après 2020, 2021)
En 2020, l'écart de richesse était une préoccupation majeure. L'attention s'est portée sur les mesures COVID-19 en 2021. Cette année, l'enquête a révélé que beaucoup, en particulier les jeunes, perçoivent des conflits d'intérêts croissants entre les générations plus âgées et plus jeunes. Alors que seulement une personne sur cinq de plus de 45 ans identifie une fracture générationnelle significative, une majorité de 18-25 ans estime que jeunes et moins jeunes en Suisse s'éloignent.
Au-delà de la fracture générationnelle
Lors d'une conférence à l'Université des Seniors de Berne, le géographe politique et co-fondateur de Sotomo, Michael Hermann, a présenté son analyse. Il a minimisé l'idée d'un profond conflit générationnel en Suisse. Hermann a déclaré : « Un fossé profond n'existe pas. » Il a soutenu que d'autres lignes de faille sociétales sont ressenties plus fortement par la population.
« Un fossé profond n'existe pas. D'autres divisions sociétales sont perçues plus fortement. »
Michael Hermann, Géographe politique
L'étude met en évidence d'autres domaines de division sociétale perçue. Par exemple, 66 % des répondants estiment que la Suisse s'éloigne politiquement entre la droite (UDC) et la gauche (PS/Verts). 65 % voient un fossé croissant entre riches et pauvres. Un nombre significatif de 51 % perçoivent une fracture entre les zones urbaines et rurales, et 43 % estiment que les conflits d'intérêts entre citoyens suisses et étrangers augmentent.
Le rôle des médias dans la polarisation politique
Hermann suggère que la fracture politique entre droite et gauche est largement influencée par la dynamique médiatique. Les politiciens, sous l'intense surveillance des médias, se sentent obligés de se différencier et d'adopter des positions plus extrêmes. Il émet l'hypothèse que sans cette attention médiatique constante, ils seraient plus enclins au compromis. Hermann a également noté une tendance où les gouvernements et les parlements des grandes villes comme Berne, Zurich et Bâle sont de plus en plus perçus comme radicaux.
La cohésion durable de la Suisse
Malgré ces diverses divisions perçues, Hermann estime que la Suisse ne s'effondre pas. Il souligne que la démocratie directe unique du pays est une force unificatrice. Différentes lignes de conflit conduisent souvent à de nouvelles alliances, surtout après les votes populaires. Les perdants d'hier peuvent devenir les gagnants de demain, et vice versa. Cette dynamique renforce la cohésion sociale et la confiance du public dans le jugement de l'électorat.
Le rôle de la démocratie directe
Le système de démocratie directe de la Suisse permet aux citoyens de voter sur les propositions législatives et les amendements constitutionnels. Ce processus favorise l'engagement et peut conduire à des alliances changeantes, empêchant une fragmentation sociétale profonde.
Hermann trouve acceptable que les citoyens ne comprennent pas tous les détails des propositions complexes. Il estime que le processus de démocratie directe lui-même est crucial. Les médias et le discours public jouent un rôle plus important dans la formation de l'opinion qu'une compréhension complète de chaque question. La forte cohésion sociale de la Suisse, malgré sa diversité linguistique, culturelle et confessionnelle, en est un témoignage. Hermann attribue cela en partie à la compréhension des travailleurs pour les préoccupations économiques, ce qui a été démontré à plusieurs reprises lors des votes populaires.
De l'optimisme au pessimisme : un changement générationnel
Le dernier « Generationenbarometer » révèle un changement notable dans les perspectives d'avenir. Les jeunes générations sont nettement plus pessimistes quant à l'avenir que les répondants plus âgés. La satisfaction de vie et la confiance en son avenir semblent décliner, même si la Génération Z a théoriquement plus de marge de manœuvre pour façonner activement sa vie que les autres groupes d'âge. Hermann déplore que les jeunes ne saisissent souvent pas ces opportunités, en particulier lors des votes populaires.
Cette tendance contraste fortement avec l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 1960. Au cours de cette période, les avancées économiques et technologiques ont alimenté un plus grand optimisme chez les jeunes. Ils ont vu et saisi des opportunités dans le boom général de l'après-guerre. La révolte de 1968 a marqué un tournant, l'optimisme et le pessimisme s'équilibrant dans les années 1970. Depuis la pandémie de COVID-19, une croyance prévalente est apparue selon laquelle la classe moyenne plus âgée a une vie plus facile que les jeunes générations, qui font face à des attentes plus élevées.
Le « principe du c'est mon tour »
Hermann identifie un phénomène qu'il appelle le « principe du c'est mon tour » comme un facteur clé influençant les récents votes populaires. Ce principe, selon lui, a été décisif dans plusieurs référendums importants. La mondialisation, la numérisation et les excès de la société axée sur la performance ont accru la pression sur les travailleurs, contribuant à cet état d'esprit.
Par exemple, la classe moyenne plus âgée s'est considérablement mobilisée pour décider du vote sur la 13e rente AVS. De même, le vote pour abolir la valeur locative imputée a été porté par les propriétaires, les propriétaires d'appartements et ceux qui espéraient devenir propriétaires. Hermann suggère que la solidarité avec les personnes moins aisées et avec les jeunes générations a été mise de côté dans ces décisions. Cette évolution a été influencée par des événements tels que l'immobilisation de Swissair, les salaires élevés des managers et la pression migratoire accrue.
De nombreux électeurs ressentent désormais implicitement que d'autres ont bénéficié ces dernières années, et que c'est maintenant leur tour. Le « Generationenbarometer » reflète clairement ce changement de sentiment. De nouvelles anxiétés concernant des pertes potentielles entravent la prise de risque et l'innovation, en particulier chez la jeune génération.
Un appel à l'engagement des jeunes
Les recommandations de Hermann aux membres de l'Université des Seniors de Berne ciblent principalement les jeunes générations. Il les exhorte à participer plus activement à la démocratie directe par le biais du vote et des élections. Il estime qu'un débat ouvert favorise le discours sur les intérêts divergents et empêche la formation de nouvelles divisions.
En outre, Hermann plaide pour l'abaissement de l'âge de vote à 16 ans. Il estime qu'il est temps d'impliquer les jeunes plus tôt dans les décisions politiques. Il rejette également les craintes concernant de nouveaux accords avec l'Union européenne, déclarant : « Ceux-ci favorisent l'innovation. Et en matière d'innovation, nous, les Suisses, ne sommes pas les pires. »